«Maintenant, je vis la science par procuration»
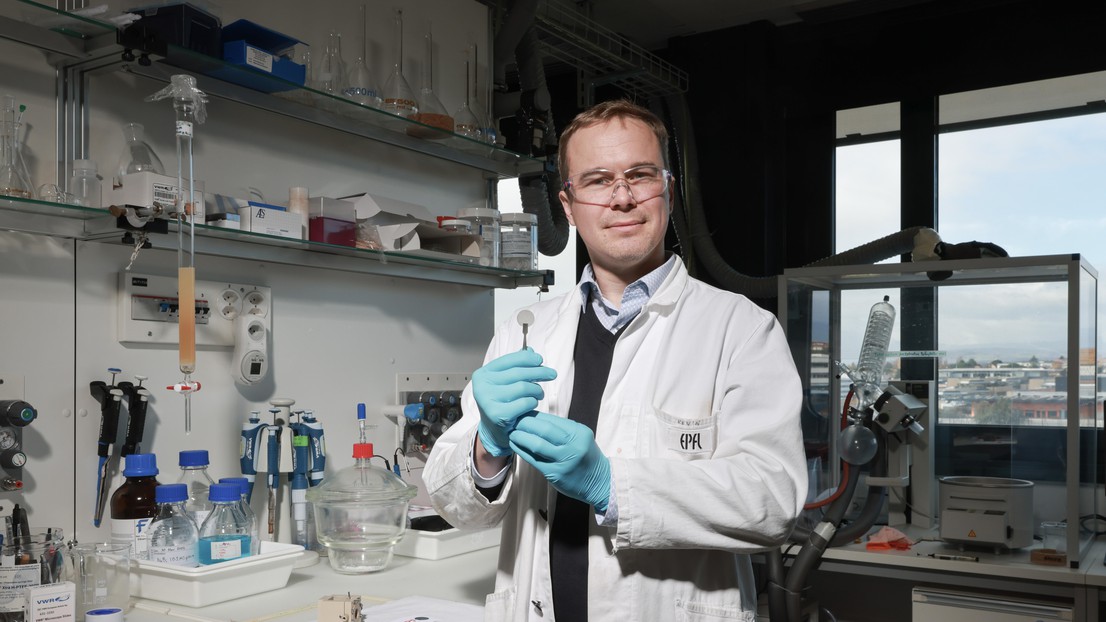
Kevin Sivula au laboratoire. © 2025 EPFL / Alain Herzog
Kevin Sivula est animé par le désir de comprendre la nature de systèmes chimiques qui convertissent l’énergie solaire en carburants. Sa fascination pour les changements de couleur est le dénominateur commun de tous ses travaux.
Sa passion repose sur l’énergie que l’on peut tirer de la lumière. Kevin Sivula, professeur de génie chimique au Laboratoire d’ingénierie moléculaire des nanomatériaux optoélectroniques de l’EPFL, est animé par la curiosité. Il éprouve une fascination particulière pour le rôle de la couleur et ses interactions avec la lumière dans les systèmes chimiques. L’automne dernier, le chercheur d’origine américaine a été nommé directeur de l’Institut de sciences et de génie chimique à l’EPFL.
«Dès mon plus jeune âge, j’ai éprouvé un intérêt pour les couleurs des matériaux, mais j’ai fini par me concentrer sur la récupération de la lumière solaire. Par exemple, quand la lumière est absorbée par un matériau, comment tirer parti de cet état d’excitation pour produire de l’électricité, comment stocker cette dernière sous forme d’un carburant et apporter une valeur ajoutée, en termes chimiques, que l’on pourrait exploiter pour mettre en place une potentielle économie circulaire et durable», détaille-t-il.
«Tout ce qui a une couleur, comme les pigments des vêtements, est coloré parce qu’il absorbe ou interagit d’une manière ou d’une autre avec la lumière visible. Mais en quoi consiste précisément l’interaction au moment où la lumière est absorbée? Dans un matériau moléculaire — comme les pigments d’un vêtement — la lumière propulse un électron à un degré d’énergie supérieur. Et quand cet électron retourne à un niveau d’énergie plus bas et plus stable, il émet probablement une petite vibration sous forme de chaleur. Toute l’idée derrière l’énergie solaire et son exploitation repose sur la tentative de tirer parti de cet état d’excitation avant qu’il ne soit converti en chaleur.»
Kevin Sivula a grandi à Minneapolis, au Minnesota. Il se rappelle le kit de chimie que lui a alors offert son père. Celui-ci, ingénieur en mécanique et aéronautique, lui a indirectement transmis l’idée qu’en ingénierie, il faut mettre les mains dans le cambouis. «Enfant, j’étais vraiment fasciné par ce kit de chimie. Il m’a poussé à investiguer les propriétés des matériaux, les degrés d’oxydation, les changements de couleur. Le kit comprenait un phenopen — un indicateur de pH qui changeait vivement de couleur, simplement en ajoutant du vinaigre ou de l’eau ammoniacale. J’étais plus intéressé par l’aptitude du phenopen à changer de couleur que par les propriétés de la solution!»
A 11 ou 12 ans, Kevin Sivula savait que l’ingénierie chimique était sa vocation. Mais, admet-il, «j’ignorais ce que c’était vraiment, et ce n’est qu’à 17 ou 18 ans que j’ai effectivement commencé à explorer ce plan de carrière.»
Des études supérieures à la chaire professorale
Kevin Sivula choisit de poursuivre une licence en ingénierie chimique à l’Université du Minnesota, à cause de la réputation de son programme dans cette discipline. Il est conscient de sa chance de pouvoir rester chez lui avec sa famille. Issu d’une famille de non-scientifiques, il aurait poursuivi sa carrière dans l’industrie sans l’expert en polymères Frank Bates, qui encourageait les meilleurs étudiants sur la voie doctorale, tout en étant payés pour ce faire.
Il effectue ensuite son doctorat à Berkeley, sous la direction de Jean Fréchet. Sans surprise, il est fasciné par les propriétés du polymèreP3HT, qui change de couleur pendant un processus appelé «spin coating». «Au départ, le polymère en solution est orange, explique-t-il. On l’applique en couche fine sur une surface, c’est-à-dire qu’on dépose un peu de la solution sur du verre, puis on imprime un mouvement de rotation. Rapidement, le polymère passe de l’orange au violet foncé! Ce changement spectaculaire se produit lorsque le polymère dissous passe à l’état solide, ce qui réorganise les orbitales électroniques et, finalement, affecte la couleur.» Son travail de doctorat consiste à utiliser ce matériau dans une cellule solaire photovoltaïque. «Ma thèse était au croisement des matériaux et de la chimie. J’ai dû concevoir mon prototype, ce qui impliquait de comprendre l’électronique et comment on fabrique une cellule solaire fonctionnelle. Un grand défi.»
Dans la foulée, Kevin Sivula entame son postdoc outre-Atlantique dans le domaine de la photosynthèse artificielle, avec le professeur de l’EPFL Michael Graetzel. Il a tôt fait d’être promu chef du groupe des carburants solaires. En 2011, il accepte une offre de professeur assistant tenure track à l’EPFL, où il continue de diriger des travaux sur le développement de nouveaux matériaux optoélectroniques et l’exploitation de l’énergie solaire pour des carburants plus écologiques.
Se mettre au défi et repousser les limites
De ses propre dires, Kevin Sivula a eu de la chance. Il s’est trouvé au bon endroit au bon moment pour parvenir là où il est aujourd’hui. Pour autant, il s’est toujours lancé des défis pour repousser ses limites, que ce soit pour trouver une solution, finir premier de classe ou mettre à l’épreuve ses idées dans des expériences. «Il ne suffit pas de travailler dur dans la recherche académique, insiste-t-il. Même une formation prestigieuse et des notes impeccables ne suffisaient pas, j’ai dû tout donner et me surpasser.»
Le chercheur a appris à sortir de sa zone de confort, par exemple quand il cherchait à rejoindre le laboratoire de Michael Graetzel, mais n’avait toujours pas reçu de réponse à sa postulation. «Michael venait à San Francisco pour une conférence. J’ai donc profité de l’occasion pour me présenter à lui directement et lui signifier mon intérêt à rejoindre son groupe dédié à la photosynthèse artificielle. Ça a retenu son attention, et il m’a enjoint à donner suite par email. Mais comme je n’avais pas reçu de réponse immédiate, j’ai contacté un postdoc du groupe, qui m’a mis en rapport avec le secrétariat de Michael — et ça a débouché sur un entretien.»
Il a aussi appris à se fier à son instinct. Par exemple, lors de plusieurs moments de révélations, quand il cherchait à déposer des couches de rouille (de l’oxyde de fer) sur des cellules solaires pour fabriquer un dispositif de séparation de l’eau. «À chaque fois que l’on avait tenté de déposer une couche fine d’oxyde de fer sur du verre, le prototype affichait de très médiocres performances. Mon idée était qu’il fallait peut-être le chauffer à de plus hautes températures pour obtenir une meilleure adhésion des particules entre elles. Mais au-delà de 500°C, le substrat de verre fond. J’ai donc essayé un autre type de verre, celui que l’on retrouve sur les plaques de cuisson, c’est-à-dire du verre borosilicaté d’aluminium. J’ai découvert que la température idéale était de 800°C. Cela a ouvert une nouvelle voie de recherche.»
Qu’est-ce qu’il apprécie dans le monde académique?
«Le meilleur moment de ma carrière de chercheur était mon postdoc, quand je n’avais que 60 ou 80 heures par semaine à passer au labo pour comprendre le fonctionnement des matériaux. C’était le moment de ma vie où je considère avoir fait une véritable découverte. Maintenant, je vis par procuration à travers les expériences de mes chercheurs et étudiants. J’aime toujours penser à la manière d’expliquer les résultats, aux prochaines expériences qui permettront de mieux comprendre ce qui se passe et de faire progresser nos matériaux vers des applications pratiques.»